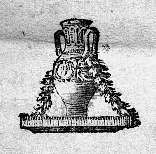
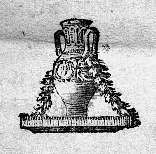
LA vie des grands Capitaines étant toujours extrêmement intéressante, j'ai cru que le public recevroit avec plaisir celle que je lui procure aujourd'hui d'un des plus renommés d'entre eux.
Une autre raison pourra contribuer à la lui faire recevoir agréablement ; c'est qu'elle a été écrite par un homme fort attaché à la famille de ce grand Capitaine, dans laquelle il a presque toujours vécu, et qui ne lui a refusé aucun des secours nécessaires pour en faire un bon ouvrage. C'est ce qu'on pourra facilement remarquer par les mémoires secrets, et les lettres d'état qu'il cite de temps en temps.
D'ailleurs,
s'il s'y trouve par-ci par là quelques petites négligences
de style, c'est qu'on a mieux aimé le donner fidèlement,
tel qu'on l'avoit reçut, que d'altérer la diction d'un écrivain
déjà connu, et de réformer son ouvrage.
Pour
en rendre la lecture plus utile, on a pris soin d'ajouter dans le livre
IV, une petite remarque qui a paru nécessaire pour faire reconnoître
le génie désintéressé du héros de cet
ouvrage.
Les médailles
sont toutes placées à la fin dans cette édition, et
renvoyées par des numéros : il ne faudroit, pour juger de
la préférence qu'elle mérite sur les anciennes éditions,
que confronter la médaille N.° 6, dont on avoit changé
la représentation et la légende ; presque toutes les autres
étoient défectueuses.

LE règne de Louis XIV fut signalé dès son commencement par un si grand nombre de victoires et de conquêtes, que rien n'avoit fait plus d'honneur aux François depuis l'établissement de leur monarchie. J'entreprends d'écrire la vie d'un capitaine qu'on doit regarder comme le principal instrument de ces victoires et de ces conquêtes ; d'un général d'armée que la France peut opposer, non-seulement à tous ceux des derniers siècles, de quelque nation qu'ils soient, mais encore aux Grecs, aux Romains et à tous les autres grands capitaines de l'antiquité, car tel est le vicomte de Turenne.
Je n'ignore pas les difficultés de l'entreprise dont je me charge. Je sais quelle est l'attente du public touchant cet ouvrage. Cependant, pour la remplir, on n'a que la vie d'un homme, qui a fait, à la vérité, les actions les plus grandes, mais qui sont encore moins grandes par elles-mêmes, que par le principe qui les produit, par les motifs d'où elles partent, par les sentimens qui les accompagnent ; toutes choses où il n'est presque pas permis à l'historien de fouiller.
Si l'on n'avoit à écrire que la vie d'un héros de quelque siècle fort éloigné du nôtre, il seroit aisé de composer son histoire, sans craindre d'être contredit par aucun témoin, en ramassant tout ce qui se trouveroit de lui dans les livres. Mais quantité de personnes qui ont vécu avec le vicomte de Turenne, vivent encore : c'est aux officiers et aux soldats qui ont servi sous lui, qu'il faut que l'historien raconte ce qu'ils ont fait eux-mêmes, et ce qu'il n'a pas vu. Il faut faire une histoire détachée, pour un homme qui a eu tant de part aux événements publics, qu'il semble qu'il faudroit écrire l'histoire générale de son temps, pour bien faire la sienne.
D'ailleurs, comment conserver le génie du style historique, en racontant certaines actions si grandes et si élevées, que le récit le plus simple qu'on en puisse faire, ne sauroit manquer d'avoir toujours je ne sais quel air d'éloge et de panégyrique ?
Telles sont les difficultés qu’il y a à faire l’histoire du vicomte de Turenne. Plus d’un écrivain y a déjà succombé, et il semble qu’elles devroient détourner tout le monde de l’entreprendre, outre que personne ne paroît avoir moins besoin d’histoire que ce prince, les choses qu’il a faites pour le bien et pour la gloire du royaume étant d’une nature à ne pouvoir jamais être oubliées. En effet, il n’y a point de François qui ne sache de quoi la France lui est redevable ; il n’y a point de père qui ne l’apprenne à son fils : de sorte que, sans le secours de l’histoire, ce qu’il a fait ne sauroit manquer de passer jusqu’à la dernière postérité ; mais outre ces actions éclatantes, que presque personne n’ignore, il y en a beaucoup qui sont moins connues, et dont je crois être assez instruit pour en faire part au public, les ayant apprises par le moyen des mémoires particuliers qui m’ont été communiqués. Ces mémoires sont ceux du vicomte de Turenne, qu’il commença à écrire de sa propre main, sitôt qu’il fut à la tête des armées ; les lettres du roi et des secrétaires d’état qui lui ont été écrites pendant tout le temps qu’il a commandé, et ses réponses à ces lettres.
Des personnes d’une haute distinction m’ayant procuré ces diverses pièces, dont on peut tirer de si grands secours pour son histoire, je me trouve engagé, par leurs instances, à les mettre en oeuvre, et à faire tous mes efforts pour répondre à la confiance dont on m’a honoré.
Je vais donc essayer de raconter tout ce qu’a fait le vicomte de Turenne, soit en France, soit dans les pays étrangers, durant la plus grande partie du siècle passé.
Je tâcherai de faire connoître cette profonde intelligence avec laquelle, ayant formé le plan de sa campagne, il savoit où il rencontreroit les ennemis, où il leur livreroit bataille, et tous les mouvemens qu’il leur feroit faire ; ce caractère particulier de valeur, qui le rendoit en même temps si circonspect à donner des batailles, et si prompt à s’y déterminer dans l’occasion ; car, quoique, pour ménager le sang de ses soldats, il évitât autant qu’il pouvoit d’attaquer les ennemis, il prenoit néanmoins si promptement son parti, lorsqu’il étoit nécessaire d’en venir aux mains, qu’il ordonnoit un combat et une bataille, comme un autre auroit fait un simple campement et une simple marche, sans assembler pour cela de conseil ; de quoi même qui que ce soit ne se formalisoit, la supériorité de ses lumières reconnues, faisant que personne ne s’offensoit de n’être pas consulté. Je ferai voir cette disposition d’esprit si sage, qui le porta toujours à penser modestement de lui-même avant le combat, et à parler des ennemis avec honneur après la victoire.
Je dirai comment sa vertu naissante excita d’abord la jalousie, et comment son mérite s’accrut par la suite jusqu’à un tel point, qu’il fit de son vivant même taire la médisance, et que ses concurrens cessèrent enfin d’être ses envieux, et applaudirent comme les autres à sa gloire.
Il n’y a rien dans ces derniers siècles qui puisse nous fournir une idée juste de la simplicité qui étoit le véritable fond de son caractère : il faut remonter pour cela jusqu’au premier âge de la république Romaine, et c’est là où, dans les sentimens d’un petit nombre de capitaines également grands et modestes, nous trouverons des traits par le moyen desquels nous pouvons nous former quelque image de ce caractère simple, qui a porté à un si haut point de grandeur le vicomte de Turenne. Cette réputation générale qu’il s’est acquise, il ne la doit à rien de ce qui éblouit la plupart des hommes. Il n’avoit l’air important, ni même l’extérieur prévenant ; mais une aimable simplicité accompagnoit toutes ses paroles et ses actions ; vertu rare dans une aussi grande élévation que celle où il étoit, et qui, jointe à ce génie éminent qu’il avoit pour la guerre, le fit adorer de tout le monde, ainsi qu’on le verra dans la suite de son histoire.
H E N R I D E L A T O U R D’ A U V E R G N E , vicomte de Turenne, naquit à Sedan le 11 septembre de l’année 1611. Il étoit le second fils de Henri de la Tour d’Auvergne, duc de Bouillon, prince souverain de Sedan, et d’Elisabeth de Nassau, fille de Guillaume de Nassau, premier du nom, prince d’Orange. Ainsi, du côté parternel, il tiroit son origine des anciens comtes d’Auvergne, dont la maison, par ses alliances, tient à ce qu’il y a de plus grand en Europe pour la naissance ; et du côté maternel, il descendoit de la maison de Nassau, qui a donné un empereur à l’Allemagne, plusieurs capitaines généraux à la république de Hollande, et un roi à l’Angleterre.
Comment les parens du vicomte de Turenne étoient de la religion prétendue réformée, ils le firent élever à Sedan, dans les principes de cette religion. Sitôt qu’il fut en âge d’avoir des maîtres, le duc de Bouillon, son père, mit auprès de lui des gens capables de lui donner une éducation digne de sa naissance et des grandes vues qu’il avoit pour lui. Dans ces premières années où l’homme, encore incapable de déguisement, découvre également ses bonnes et ses mauvaises qualités, il fit voir une maturité si fort au-dessus de son âge, un si grand empire sur lui-même, et une disposition d’esprit si préparée à embrasser tout ce qu’on lui proposoit de raisonnable, qu’on jugea bien dès-lors qu’il étoit né pour donner au monde de grands exemples de vertu.
Le temps de l'éducation domestique étant fini, et le Duc de Bouillon étant venu à mourir, la duchesse de Bouillon, chargée de la conduite de ses enfants, envoya le vicomte de Turenne en Hollande pour y apprendre le métier de la guerre sous le prince Maurice de Nassau son frère, qui passoit à juste titre pour un des plus grands capitaines de son siècle.
Sitôt que le vicomte de Turenne fut arrivé en Hollande, le prince Maurice son oncle voulut savoir quel étoit son caractère, et il l'entretint long-temps pour cela sur toutes les choses qui pouvoient le lui faire connoître à fond. Le vicomte de Turenne avoit naturellement je ne sais quel embarras dans la langue, qui faisoit que lorsqu'il vouloit parler il demeuroit quelquefois un petit instant sur la première syllabe de certains mots avant que de les achever ; mais tout ce qu'il disoit étoit si sensé et si juste, que cette petite difficulté qu'il avoit à s'énoncer, n'empêcha point que le prince Maurice ne conçût de lui une idée très-avantageuse. Il lui fit aussitôt prendre un mousquet, et voulut qu'il servît comme un simple soldat, avant que de l'élever à aucun grade.
Le vicomte de Turenne qui ne respiroit que les fonctions du métier, n'en refusa et n'en dédaigna aucune ; il ne trouva rien de bas pour lui, ni de trop pénible. Le capitaine sous qui on le mit, étoit né vassal du duc de Bouillon son père, et le vicomte de Turenne lui obéissoit comme le moindre soldat de la compagnie ; il ne se plaignoit ni des incommodités du climat, ni des injures des saisons. Enfin il fit paroître, dans tous les exercices, tant de fermeté et de patience, et une si grande application au service, que le prince Maurice, charmé des heureuses dispositions qu'il lui trouvoit pour la guerre, se proposoit de prendre soin de les cultiver, et s'en faisoit déjà un plaisir par avance, lorsque par malheur il vint à mourir. Ainsi on peut dire que le vicomte de Turenne s'est formé lui-même, n'ayant plus servi depuis sous aucun capitaine de qui on puisse avoir lieu de croire qu'il ait rien appris de tout ce qu'il a exécuté de grand dans l'art militaire. Après la mort du prince Maurice de Nassau, les Hollandois ayant remis le gouvernement général de leurs armées au prince Frédéric Henri son frère, ce prince donna au vicomte de Turenne une compagnie d'infanterie, à la tête de laquelle il servit aux sièges de Groll et de Bolduc, et montra qu'il n'étoit pas moins bon officier que bon soldat. On ne voyait point, dans toute l'armée, de compagnie plus belle ni mieux disciplinée, que la sienne. Tout jeune qu'il étoit, il ne s'en reposoit point sur les soins d'un lieutenant ; il faisoit lui-même faire l'exercice aux soldats, il les dressoit avec patience, il les formoit avec bonté, il les corrigeoit à propos, et sa bourse leur étoit ouverte dans tous leurs besoins. Il alloit toujours le premier à la tranchée et aux attaques. Son gouverneur qui étoit un homme de service, s'efforçoit en vain d'empêcher qu'il ne s'exposât comme il faisoit ; hors de là, il le respectoit comme son père ; mais quand il s'agissoit de donner l'exemple à ceux à la tête de qui il étoit, il n'avoit égard qu'à ce que demandoit son honneur. Le prince Frédéric Henri son oncle, crut même devoir lui reprocher, comme une ardeur immodérée, ce courage qui ne connoissoit point de péril, afin de lui donner quelques bornes ; mail il avoit bien de la peine à dissimuler la joie qu'il ressentoit d'être obligé à lui faire de tels reproches, dans le temps même qu'il lui faisoit : jusque-là qu'un jour, après lui avoir fait une de ces sortes de réprimandes, il se tourna vers les officiers qui étoient présens, et leur dit qu'il se trompoit fort, ou que ce jeune homme effaceroit la gloire des plus grands capitaines. Aussi n’y avoit-il pas un seul des soldats de sa compagnie qui n’eût eu honte de ne le pas suivre aux endroits même les plus périlleux, et de n’y pas faire paroître de la bravoure à son exemple. Celui qui a donné sa vie au public, avant moi, raconte plusieurs actions fort brillantes que le vicomte de Turenne fit, à ce qu’il prétend, n’étant encore que simple capitaine, et je pourrois en embellir ici cette histoire ; mais n’en trouvant aucune preuve en nul autre endroit, et n’estimant pas que le témoignage d’un particulier suffise pour fonder la certitude d’un fait historique, je ne les rapporterai point. J’aime mieux m’exposer au reproche d’avoir omis quelques actions glorieuses à la mémoire du prince dont j’écris la vie, qu’à celui d’en avoir supposé pour lui faire honneur ; et je veux raconter toutes choses avec tant d’exactitude et de sincérité, que cet ouvrage ne soit pas moins un monument de la fidélité avec laquelle on doit écrire l’histoire, que de la gloire immortelle du vicomte de Turenne. Cependant, il continuoit de servir en Hollande. Les François qui s’y trouvoient en grand nombre, et qui avoient été témoins de ses actions et de sa conduite, en avoient écrit plusieurs fois à la cour ; ils en parloient comme d’un prodige de sagesse, et il étoit déjà connu en France, lorsque les affaires de sa maison l’obligèrent à s’y rendre. Mais avant que de raconter ce qu’il fit pour le service de cette couronne, aux intérêts de laquelle il demeura attaché pendant presque tout le reste de sa vie, il est à propos de faire connoître quelle étoit, dans ce temps-là, la disposition de la France, tant pour les affaires de dedans du royaume, que par rapport aux états voisins, et de donner une idée du caractère de ceux qui avoient part au gouvernement.
Louis XIII, qui régnoit alors, avoit bien su connoître que le cardinal de Richelieu avoit un génie supérieur à celui de toutes les autres personnes qui entroient dans son conseil ; et persuadé qu’il avoit d’ailleurs du zèle pour son service et de l’attachement pour sa personne, il l’avoit fait son premier ministre, et lui avoit remis l’administration générale de toutes les affaires.
Le cardinal de Richelieu se voyant maître de disposer comme il voudroit de la puissance souveraine, résolut d’élever la France à un si grand point de grandeur, que son ministère devint célèbre dans tous les siècles à venir. Il falloit pour cela abaisser la maison d’Autriche, qui, possédant l’empire d’Allemagne et la monarchie d’Espagne, se trouvoit fort au-dessus de toutes les autres maisons de l’Europe ; et c’est aussi ce qu’il avoit entrepris de faire. Mais comme l’autorité de Louis XIII n’étoit pas fort absolue dans son propre royaume, le cardinal de Richelieu n’avoit pas osé d’abord faire déclarer ouvertement la France contre la maison d’Autriche. Il s’étoit contenté d’assister, comme alliés, les Suédois et les Hollandois, qui étoient en guerre avec l’Empereur et avec le roi d’Espagne ; et afin de pouvoir bientôt tourner toutes les forces de la France contre les Impériaux et contre les Espagnols, il appliquoit tous ses soins à rendre le roi si absolu chez lui, qu’il n’eût plus rien à craindre du dedans du royaume, lorsqu’il porteroit la guerre au dehors ; car la puissance souveraine partagée, comme elle l’étoit alors, se trouvoit réduite à bien peu de chose. La reine mère, le duc d’Orléans, frère du roi, les princes du sang, et les grands du royaume, vouloient tous avoir part au gouvernement. Les parlemens prenoient connoissance des affaires d’état ; les Calvinistes avoient des chefs et des places de sûreté ; les mécontents entretenoient des liaisons avec les ducs de Lorraine et de Bouillon, qui, par le moyen de Nancy et de Sedan, places si voisines de la France, leur fournissoient dans le besoin des retraites faciles et assurées.
Le cardinal de Richelieu, avant que de rien entreprendre contre les étrangers, obligea la reine mère à sortir du royaume, et les princes du sang à se contenter de leur apanage. Il fit couper la tête à quelques-uns des grands, et arrêta les autres par la crainte du même traitement ; il réduisit les Parlemens à ne plus se mêler d’autres affaires que de celles des particuliers ; il enleva aux Calvinistes la Rochelle, et leurs autres forteresses les plus considérables ; il envoya une armée dans la Lorraine, pour se rendre maître des principales places de ce duché ; et enfin, il fit signer à la duchesse douairière de Bouillon un traité, par lequel elle promettoit de demeurer toujours attachée aux intérêts du roi, qui de son côté s’engageoit à prendre sa maison sous sa protection.
Telle étoit la situation des affaires de la France, lorsque la duchesse de Bouillon ayant appris que le cardinal de Richelieu, non content du traité qu’il lui avoit fait signer, avoit dessein de lui demander qu’elle reçût garnison Françoise dans Sedan, elle jugea à propos d’envoyer le vicomte de Turenne en France, afin qu’il y servît comme d’ôtage et de caution des engagemens qu’elle avoit contractés avec cette couronne, et qu’on ne lui fit pas de nouvelles propositions au préjudice de la souverainté du duc de Bouillon son fils aîné.
Le vicomte de Turenne étant donc allé à la cour de France, il fut reçu du roi et du cardinal de Richelieu, avec tous les honneurs et toutes les caresses que lui devoient attirer sa naissance et son mérite personnel, et on lui donna un régiment d’infanterie, à la tête duquel il servit au siége de la Mothe ; car le cardinal de Richelieu ayant envoyé ordre au maréchal de la Force d’assiéger cette ville, qui étoit la seule place considérable qui restât au duc de Lorraine, le régiment de Turenne fut du nombre de ceux qu’on destina pour cette expédition.
La Mothe étoit une forteresse située sur le haut d’un rocher fort élevé, et d’une dureté à l’épreuve de la sape et de la mine. Lorsque le maréchal de la Force eut avancé ses travaux d’une manière à pouvoir attaquer un des bastions de la place, il envoya le marquis de Tonneins son fils avec son régiment, qui y fut si maltraité, qu’il fut contraint de venir se renfermer dans les lignes. Le lendemain, le vicomte de Turenne fut commandé avec son régiment pour attaquer ce même bastion. Chacun avoit les yeux tournés sur ce jeune colonel, et sa réputation naissante rendoit toute l’armée attentive à l’événement de cette entreprise. Les assiégés faisoient non-seulement un très-grand feu, mais ils transportoient encore sur leurs remparts des pierres d’une grosseur prodigieuse : ils les jetoient de dessus le parapet ; et ces pierres venant à donner sur les pointes de la roche en tombant, se fendoient en pièces et en éclats, qui, volant de part et d’autre, tuoient ou estropioient par-tout les assiégeans. Malgré tout cela, le vicomte de Turenne s’avança d’un grand sang-froid vers la brèche : les soldats de son régiment, fiers de l’avoir à leur tête, ne furent arrêtés par aucun danger, quelque grand qu’il fût. Les assiégés, animés par l’avantage qu’ils avoient eu le jour précédent, firent les derniers efforts pour chasser le vicomte de Turenne, qui faisoit tout ensemble le devoir de capitaine et celui de soldat, attaquant les ennemis avec vigueur, et donnant ses ordres avec beaucoup de présence d’esprit, au milieu des morts et des blessés que le canon, la mousqueterie et les pierres faisoient tomber à ses côtés. Ainsi, malgré les efforts des ennemis, qui se battirent en désespérés, il les chassa du bastion, y fit son logement, et fut cause en partie de la prise de la ville. Il en reçut des complimens de toute l’armée, et ensuite de toute la cour, quand on y eut appris ce qu’il avoit fait pour la prise de cette place ; car le maréchal de la Force lui rendit toute la justice qui lui étoit due, dans la relation qu’il envoya de siége au cardinal de Richelieu : générosité rare dans ceux qui commandent les armées, et qui toucha tellement le vicomte de Turenne, que préférant l’alliance de ce maréchal à toute autre, il épousa sa petite-fille, comme nous le verrons dans la suite de cette histoire. Il semble que le marquis de Tonneins auroit dû être fort piqué d’avoir échoué dans une entreprise où le vicomte de Turenne avoit si heureusement réussi ; et il l’auroit peut-être été, s’il avoit eu affaire avec un concurrent qui en eût tiré vanité ; mais la modestie du vicomte de Turenne étoit telle, que le marquis de Tonneins ne put lui envier l’honneur d’un succès si glorieux.
Le cardinal de Richelieu regardant le vicomte de Turenne comme un homme dont l’expérience et le jugement devançoient de beaucoup l’âge, le fit maréchal de camp, quoiqu’il n’eût que vingt-trois ans, et que le grade de maréchal de camp fût alors le premier après celui de maréchal de France.
L’année suivante, l’Empereur ayant fait assiéger la ville de Mayence, dont les Suédois s’étoient rendus maîtres en 1631, sous la conduite du grand Gustave, le cardinal de Richelieu envoya au secours des Suédois le cardinal de la Valette, à la tête d’une armée, et lui donna pour maréchal de camp le vicomte de Turenne. A l’approche des François, les Impériaux levèrent le siége. Le cardinal de la Valette s’approcha aussitôt de Mayence, et y jeta toutes les munitions dont cette grande ville avoit besoin ; imprudence que les Impériaux avoient bien jugé qu’il ne manqueroit pas de commettre. Aussi ne se fut-il pas plutôt défait de ses vivres, que les généraux de l’empereur, qui s’étoient rendus maîtres des passages par où il en pouvoit faire venir, empêchèrent de telle sorte qu’on n’en apportât dans son camp, qu’on y manqua bientôt de toutes choses. Le pain y enchérissoit de jour en jour, et devint enfin si rare, qu’il se vendoit jusqu’à un écu la livre. Dans cette extrémité, le vicomte de Turenne distribua aux soldats les provisions qu’il avoit fait apporter pour lui, et qui furent bientôt consommées. Il vendit ensuite ses équipages pour faire subsister une partie de l’armée ; la plupart des soldats ennemis s’exposant à tout pour nous apporter des vivres à cause du prix excessif qu’on leur en payoit. Mais enfin la disette devint si grande, que l'armée seroit périe, si on l'avoit laissée là plus long-temps. Il fallut donc que le cardinal de la Valette prît le parti de se retirer, quelque danger qu’il y eût à le faire devant une armée aussi nombreuse qu’étoit celle des Impériaux. Il se proposoit de décamper la nuit, et de se sauver dans les trois Evêchés par Sarbruk et Saint-Avaud, où il y avoit beaucoup de vivres ; mais les Impériaux s’étant apperçus de sa retraite, mirent aussitôt à ses trousses le général Galas, qui, avec un corps de troupes fraîches, lui coupa ce chemin facile, et le réduisit à prendre celui des montagnes, qui étoit bien plus et entièrement désert. L’histoire nous fournit peu d’exemples d’une retraite aussi triste que le fut celle-là. Les François, sans vivres, travaillés de toutes les maladies qui sont inséparables de la famine, et s’enfuyant à travers les bois et les rochers, étoient poursuivis par les Impériaux, qui avoient tout en abondance. Les fuyards ne gardoient aucun ordre dans leur marche : ceux qui pouvoient tromper la vigilance des officiers, alloient se jeter parmi les ennemis, dans l’espérance qu’ils leur donneroient de quoi assouvir la faim qui les dévoroit : la plupart s’écartoient à droite et à gauche, pour tâcher de découvrir quelque cabane, et y trouver au moins un morceau de pain. Ceux qui, épuisés de forces, ne pouvoient quitter le gros de l’armée, se traînoient le long des chemins plutôt qu’ils ne marchoient : ils dévoroient des yeux tout ce qu’ils voyoient manger aux officiers, et les officiers étoient contraints à se cacher d’eux. Le cardinal de la Valette fut obligé d’abandonner toute l’artillerie et la plus grande partie des bagages, afin de pouvoir gagner Vaudrevange, pour y passer la Saare et se mettre à couvert sous le canon de Metz, comme il le fit. Durant cette longue marche, qui dura treize jours, le vicomte de Turenne partagea avec les soldats le peu de vivres qu’il pouvoit trouver ; il fit jeter de dessus les chariots les choses les moins nécessaires, et y fit monter quantité de malheureux, qui n’avoient pas la force de marcher : en ayant trouvé un que la faim et la fatigue avoient fait tomber au pied d’un arbre, où résolu d’abandonner sa vie à la merci des ennemis, il attendoit la mort, il lui donna son propre cheval, et marcha à pied jusqu’à ce qu’il eût joint un de ses chariots, sur lequel il le fit mettre. Il consoloit les uns, il encourageoit les autres, il les aidoit et les assistoit, sans faire différence de ceux de son régiment d’avec ceux qui n’en étoient pas : si bien que tous les soldats commencèrent dès-lors à le regarder comme leur père ; car il compâtissoit à leurs peines, et il les soulageoit tous également. D’ailleurs, il combattit avec beaucoup de valeur dans tous les endroits où l’on fut obligé de faire tête aux Impériaux : il se saisit des défilés où l’on pouvoit les arrêter, et des hauteurs d’où ils nous auroient fort incommodés, s’ils les avoient occupées avant nous : il logea dans quelques masures qui se trouvèrent sur le chemin, de l’infanterie, dont le feu arrêta les ennemis en plusieurs endroits : enfin il prit des mesures si sages, et agit avec tant de vigueur, que ce qu’il fit dans cette retraite fut regardé comme un des plus grands services qui pussent être rendus à l’état.
Le mauvais succès de l’affaire de Mayence avoit tellement dégoûté le cardinal de la Valette du métier de la guerre, qu’il l’auroit abandonné pour toujours, si le cardinal de Richelieu, qui avoit ses raisons pour mettre des ecclésiastiques à la tête des armées, ne l’eût obligé bientôt après de prendre le commandement de celle qui devoit assiéger Saverne, ville d’Alsace, qui étoit alors entre les mains des Impériaux. Cependant le cardinal de la Valette ne voulut point se charger de cette entreprise, qu’il n’eût avec lui le vicomte de Turenne ; et il le demanda au cardinal de Richelieu, qui, souhaitant passionnément qu’il rétablît au plutôt son honneur, le lui accorda volontiers. Le vicomte de Turenne, touché de la confiance que ce cardinal avoit en lui, se surpassa pour ainsi dire lui-même au siége de Saverne, soit qu’il fallût aller à la tranchée, ou aux assauts qui furent donnés à la ville et au château. Les soldats n’ayant pu arracher les palissades, il sauta par-dessus, et fit ferme lui seul au-delà, jusqu’à ce que ceux qu’il commandoit fussent passés avec lui : il força les retranchemens que les ennemis avoient faits sur la brèche et dans le terre-plain du bastion : tout fut pris et emporté. Le cardinal de la Valette recouvra par-là son honneur ; mais il en pensa coûter un bras au vicomte de Turenne, qu’il eut percé d’un coup de mousquet, dont la balle lui fit une si dangereuse blessure, que quelques médecins furent d’avis qu’on ne pouvoit lui sauver la vie qu’en lui coupant le bras : on suivit néanmoins le sentiment de ceux qui n’opinèrent pas pour un si triste remède : il guérit enfin avec le temps, et l’on connut, par les alarmes que causa sa blessure, et par la joie que répandit par-tout sa guérison, combien il étoit généralement aimé et estimé.
Quelque temps après la reddition de Saverne, Galas ayant passé le Rhin, à dessein de prendre des quartiers d’hiver en Franche-Comté, avoit fait avancer ses gardes pour se saisir des postes les plus commodes et les plus avantageux de cette province. Le cardinal de la Valette en ayant été averti, envoya le vicomte de Turenne avec un détachement au devant des ennemis. Le vicomte de Turenne marcha jour et nuit ; et étant arrivé à Jussey, l’un des plus gros bourgs de la Franche-Comté, où les gardes de Galas commençoient à faire des retranchements, il les attaqua, il les défit, et força Galas à rebrousser chemin. Ce général, avant que de repasser le Rhin, voulut traverser le siége de Jonvelle, que le duc de Veimar faisoit pour nous en un autre endroit de Franche-Comté ; mais le vicomte de Turenne se posta d’une manière si avantageuse entre les Impériaux et nous, qu’il rompit toutes les mesures que prit Galas pour jeter du secours dans Jonvelle, et que cette place fut enfin forcée de se rendre au duc de Veimar.
Ces heureux succès déterminèrent le cardinal de Richelieu à donner au cardinal de la Valette le commandement de l’armée qui devoit agir en Flandres. Le cardinal de la Valette voulut encore avoir le vicomte de Turenne avec lui, et lui ayant fait ouvrir la campagne par l’attaque du château d’Hirson, qui fit très-peu de résistance, il alla investir Landrecy, ville du Hainaut, au siége de laquelle le vicomte de Turenne se donna des peines incroyables pour empêcher que ce cardinal n’eût le chagrin de voir échouer son entreprise ; car le temps devint si mauvais, et la pluie tomba en si grande abondance, que les soldats étoient jusqu’à la ceinture dans l’eau dont la tranchée étoit toute remplie. Le vicomte de Turenne y étoit entré avec eux, et n’en sortoit que pour aller rendre compte au cardinal de ce qui s’y passoit : il les encourageoit au travail et à la patience sans leur faire de longs discours, mais en leur montrant l’exemple, et en y joignant la libéralité. Il donnoit de l’argent à ceux des soldats qui avoient le plus d’expérience, pour les engager à venir dans la tranchée, même hors de leur rang. Il surmonta ainsi tous les obstacles que l’art, la nature, et les efforts des ennemis opposoient, comme de concert, aux assiégeans ; et la place se rendit enfin au cardinal de la Valette.
La prise de Landrecy fut suivie de celles des villes de Maubeuge et de Beaumont, d’où le vicomte de Turenne eut ordre d’aller prendre Solre, qui étoit le château le plus fort de tout le Hainaut, et on lui donna les régimens de Champagne et de Saint-Luc pour cette expédition. Il y avoit deux mille hommes de garnison dans ce château ; mais le vicomte de Turenne le fit attaquer si vivement, qu’en très-peu d’heures ils furent forcés de se rendre à discrétion. Les soldats entrèrent aussitôt dans la place, et y ayant trouvé une femme d’une très-grande beauté, ils la lui amenèrent comme la plus précieuse portion du butin, et celle qui devoit le plus flatter ses désirs. Le vicomte de Turenne sut se retenir sur le bord d’un précipice si dangereux, mais sans fiare parade de l’empire qu’il avoit sur lui-même, il fait semblant de ne pas pénétrer le dessein de ses soldats, et comme si en lui amenant cette femme ils n’avoient pensé qu’à la dérober à la brutalité de leurs camarades, il les loue beaucoup d’une conduite si sage ; il fait chercher son mari en diligence, et il la remet entre ses mains, en lui témoignant que c’étoit à la retenue et à la discrétion de ses soldats qu’il devoit la conservation de l’honneur de sa femme.
Les ennemis se postèrent ensuite en deçà de Maubeuge, pour empêcher la jonction des armées du cardinal de la Valette et du duc de Candale ; mais n’en ayant pu venir à bout, ils furent contraints de s’en retourner, et le vicomte de Turenne ayant eu ordre de les poursuivre avec un détachement, il en força une partie à repasser la Sambre, où il y en eut beaucoup de noyés ; il en fit passer au fil de l’épée un grand nombre dans tout le reste de la retraite, et finit par-là cette campagne.
L’année suivante le cardinal de Richelieu ayant chargé le cardinal de la Valette d’aller secourir la duchesse douairière de Savoie, qui avoit bien de la peine à se maintenir dans la régence des états du jeune Duc son fils, contre les entreprises du prince Thomas et du cardinal de Savoie, ses beaux-frères ; le cardinal de la Valette demanda encore au cardinal de Richelieu le vicomte de Turenne, et il le lui auroit accordé volontiers s’il n’avoit pas cru avoir absolument besoin de lui pour une très-grande entreprise qu’il méditoit du côté de Rhin. En effet, il avoit résolu de faire assiéger cette année-là, par le duc de Veimar, la ville de Brisac, qui étoit regardée alors comme le boulevard de l'Allemagne. Ayant donc déclaré au cardinal de la Valette qu’il n’avoit qu’à se résoudre, pour cette fois, à se passer du vicomte de Turenne, il l’envoya au duc de Veimar avec un corps de quatre mille hommes qu’il avoit levés dans le pays de Liége. Le duc de Veimar ayant reçu ce renfort, fit aussitôt avancer son armée du côté de Brisac, et se rendit maître de tous les châteaux et de tous les postes des environs, pour serrer la place de près. A la première nouvelle de cette entreprise, Goeutz et Savelli, généraux de l’armée Impériale, ayant ramassé toutes leurs troupes, se mirent en marche pour tâcher de jeter un secours d’hommes et de munitions dans Brisac avant que les avenues de cette ville leur fussent entièrement fermées. Le duc de Veimar alla au-devant d’eux jusqu’à Witthenvhir, qui est vis-à-vis de Rhinaw. Ils vouloient éviter le combat ; il les y força. Le duc de Savelli y fut blessé très-dangereusement, Goeutz prit la fuite, et les Impériaux furent si entièrement défaits, que le duc de Veimar, estimant qu’il leur étoit impossible de traverser son entreprise sur Brisac, commença à en faire le siège dans les formes. Mais à peine les lignes en furent-elles achevées, que le duc de Lorraine, qui étoit dans les intérêts de l’Empereur, se mit en marche avec un corps de troupes dans le dessein de faire lever le siège. Le duc de Veimar prit aussitôt une partie de l’armée, et laissant l’autre devant Brisac sous la conduite du comte de Guébriant et du vicomte de Turenne, il alla au-devant des ennemis, et sa victoire sur les Lorrains fut aussi complète que celle qu’il avoit remportée sur les Allemands.
Cependant Goeuts, et le général Lamboy qui avoit pris la place du duc de Savelly, ayant encore ramassé quelques troupes, vinsent à Brisac par des chemins si couverts, qu’ils arrivèrent au quartier du duc de Veimar avant qu’on se fût apperçu de leur marche. Ils reconnurent nos lignes ; ils les attaquèrent avec vigueur ; ils emportèrent deux redoutes qui les défendoient de ce côté-là, et tout plioit déjà devant eux, lorsque le comte de Guébriant et le vicomte de Turenne, avertis du danger où nous étions, accoururent au quartier du duc de Veimar, où ils soutinrent d’abord les efforts des Impériaux. Ils les poussèrent ensuite avec vigueur, ils leur firent lâcher pied, et les chassèrent entièrement de nos lignes.
Les ennemis passèrent le Rhin, et vinrent assiéger Ensishem, petite ville qui est dans le voisinage de Brisac, et de laquelle ils auroient pu nous incommoder s’ils s’en fussent rendus maîtres. Mais le vicomte de Turenne y étant allé avec une partie de notre armée, leur en fit lever le siège, les attaqua jusque dans le camp où ils s’étoient retirés, et en tailla en pièces un si grand nombre, qu’il les mit hors d’état de penser désormais à tenter le secours de Brisac.
De tous les dehors de cette place, il ne nous restoit plus à prendre que le fort nommé le ravelin de Raynach, qui, rendant les ennemis maîtres du principal bras du Rhin, leur laissoit toujours l’espérance d’être secourus par cet endroit, et les empêchoit de se rendre. Le duc de Veimar, qui avoit vu le vicomte de Turenne réussir si heureusement dans tout ce qu’il avoit entrepris durant ce siége, le chargea encore de l’attaque de ce fort. Le vicomte de Turenne y alla avec quatre cent hommes. Il fit rompre la palissade à coups de haches, ses gens y entrèrent par trois endroits à la fois, tout y fut tué ; et le gouverneur de la ville ne pouvant plus compter sur aucun secours, capitula enfin, et se rendit le 17 décembre.
Ce qu’il y a d’étonnant dans ce que le vicomte de Turenne fit pour la prise de cette place, c’est qu’il eut la fièvre quarte pendant tout le temps que dura le siége. Aussi le duc de Veimar ne pouvoit-il s’empêcher de l’embrasser au retour de chaque expédition où il l’envoyoit ; et après la reddition de la ville, il en écrivit au cardinal de Richelieu, comme d’un homme qui égaleroit bientôt les plus grands capitaines ; et cela, à la manière de ceux de sa nation, c’est-à-dire, avec je ne sais quel esprit de franchise, qui, se faisant sentir dans tout ce qu’ils disent, persuade efficacement, malgré même les expressions les plus exagérées dont ils se servent ; de manière que lorsque le vicomte de Turenne arriva à la cour, il n’y eut sortes de caresses que le cardinal de Richelieu ne lui fît, jusqu’à lui demander son amitié ; faveur qu’il n’avoit encore faite qu’aux princes du sang. Il lui offrit même une de ses plus proches parentes en mariage ; mais le vicomte de Turenne appréhendant que la différence de religion ne mît quelque obstacle à l’étroite union qui devoit être entre lui et une personne avec qui il contracteroit un pareil engagement, le dit franchement au cardinal de Richelieu, et lui fit entendre avec tant de bonne foi ce qui lui faisoit peine en cela, que le cardinal goûta ses raisons. Il trouva même un caractère d’honnête homme dans ce procédé ; de sorte que, bien loin de s’offenser de son refus, il l’en estima davantage, et continua à lui marquer sa confiance, en l’employant aux affaires les plus difficiles.
Il l’envoya en Italie, où pendant que le duc de Veimar avoit fait une si glorieuse campagne en Alsace, le cardinal de la Valette avoit perdu Yvrée, Verceil, Verrue, Nice, Coni, et plusieurs autres places considérables, dont les princes de Savoie, secourus des Espagnols, s’étoient rendus maîtres. L’Empereur ayant dans ce même temps-là fait publier un décret par lequel il déclaroit la duchesse de Savoie déchue de la tutelle du jeune duc son fils, presque tout le Piémont se souleva contr’elle, et se livra à ses beaux-frères ; de manières qu’il ne lui restoit plus que Suze, Savillian, Carignan, Chivas et la citadelle de Turin ; la ville même ayant été surprise de nuit par le prince Thomas.
Les choses étoient dans cet état lorsque le cardinal de la Valette étant venu à mourir, le cardinal de Richelieu donna ordre au comte d’Harcourt d’aller se mettre à la tête de l’armée d’Italie, où il avoit déjà envoyé le vicomte de Turenne. A l’arrivée du comte d’Harcourt, on tint conseil : on y examina l’état des troupes ; et quoique les ennemis en eussent deux fois autant que nous, on résolut de les aller chercher, quelque part qu’ils fussent. On marcha donc à Villeneuve d’Asti, où ils étoient. Les ennemis, qui auroient peut-être fait la moitié du chemin, si nous avions eu autant du monde qu’eux, étonnés de ce que nous venions les attaquer avec une armée si inférieure à la leur, non-seulement n’osèrent sortir de leurs quartiers, mais encore s’y retranchèrent ; de sorte qu’il fallut assiéger Quiers, ville en deçà de Villeneuve d’Asti, pour les obliger à sortir de leurs retranchemens. Le vicomte de Turenne se posta avec toute la cavalerie au-delà de Quiers, entre les Espagnols et le comte d’Harcourt, qui prit ainsi la ville sans aucun obstacle. Mais comme il y avoit très-peu de vivres, il n’y put pas rester long-temps, et les ennemis ayant bien prévu qu’il seroit obligé de marcher vers Carignan pour en trouver, le marquis de Léganez, à la tête des Espagnols, alla vers la hauteur de Poirin, au bas de laquelle notre armée ne pouvoit s’empêcher de passer ; et le prince Thomas marcha vers la petite rivière de Santena, qu’il nous falloit aussi nécessairement traverser. Comme le marquis de Léganez venoit de Villeneuve d’Asti, et le prince Thomas de Turin, l’armée de l’un devoit se trouver à la droite de comte d’Harcourt, et celle de l’autre à sa gauche ; de manière qu’il ne pouvoit aller à Carignan, sans s’exposer à prêter le flanc à ces deux corps de troupes, qui, selon toutes les apparences, ne devoient pas manquer à profiter de ces avantages, et à donner rudement sur son arrière-garde. Cependant il n’y avoit plus ni munitions ni fourrages à Quiers ; et il falloit tenter la retraite à quelque prix que ce fût Dans cette extrémité, le vicomte de Turenne, tout malade qu’il étoit encore de la fièvre quarte, s’offrit à aller avec deux mille hommes se rendre maître du pont sur lequel il falloit passer la rivière, et qui étoit auprès du village nommé La Route, s’engageant à défendre si bien ce poste, que les ennemis ne pourroient empêcher le passage de l’armée.
Le comte d’Harcourt, ravi de cette offre, lui donna les deux mille hommes qu’il demandoit. Le vicomte de Turenne marcha avec tant de diligence, qu’il prévint le prince Thomas ; et étant arrivé avant lui au pont, il s’en saisit, ainsi que de tous les postes des environs, d’où l’on pouvoit favoriser le passage de notre armée. Le prince Thomas y arriva peu de temps après avec neuf à dix mille hommes, et vint fondre sur le vicomte de Turenne, qui, après avoir soutenu le premier choc des ennemis, les fit charger à son tour avec tant de vigueur, qu’il rompit leurs trois lignes, et les mena battant l’espace de plus d’un mille. Le prince Thomas fut renversé deux fois dans un fossé ; et il auroit infailliblement été pris, sans l’obscurité de la nuit qui fit qu’on ne put le reconnoître, et que, malgré une déroute si générale, la plus grande partie de son armée se sauva par la fuite.
Pendant que le vicomte de Turenne étoit aux mains avec le prince Thomas, le marquis de Léganez étoit descendu de Poirin, et étoit venu avec ses Espagnols attaquer le comte d’Harcourt, qui de son côté étoit aussi demeuré victorieux des ennemis : mais comme ils ne laissoient pas de l’inquiéter encore, il n’osoit s’avancer plus près de la rivière, craignant que le prince Thomas ne se fût rendu maître des passages. Le vicomte de Turenne lui envoya dire alors qu’il n’avoit rien à craindre ; qu’il pouvoit faire avancer l’armée en assurance ; qu’il se chargeoit de faire l’arrière-garde, et qu’il lui répondoit de tout. Le comte d’Harcourt s’avança sur sa parole : tout défila devant le vicomte de Turenne, troupes, canons, bagages, et cela au petit pas, et sans aucun désordre. Il passa le dernier, et ayant mis pied à terre, il aida lui-même à rompre le pont ; après quoi le comte d’Harcourt alla sans peine à Carignan, où il mit en quartiers d’hiver une partie de l’armée, et le reste aux environs. Tel fut le combat de la Route, si célèbre sous le nom de la ROUTE DE QUIERS.
On donna presque tout l’honneur de cette victoire au vicomte de Turenne, qui en effet seconda si bien le comte d’Harcourt en cette occasion, que le cardinal de Richelieu le regarda dès-lors comme un homme capable de commander une armée en chef ; et l’éclat de cette action fut si grand, que comme s’il eût fait oublier toutes celles que le vicomte de Turenne avoit faites jusque-là, on commença à ne plus compter ses exploits, que de la route de Quiers, époque qui est restée depuis dans la mémoire de tous les François.
La campagne étant ainsi finie, le comte d’Harcourt s’en alla à Pignerol, pour y passer l’hiver. Il laissa le vicomte de Turenne à la tête de nos quartiers, pour les défendre, et il le chargea, avec cela, de ne laisser manquer de rien la citadelle de Turin, que le comte de Couvonges défendoit toujours contre le prince Thomas, qui la tenoit assiégée de dedans la ville, dont il étoit le maître.
Le vicomte de Turenne trouvant que nos troupes étoient trop serrées dans les endroits où elles s’étoient logées, et que la cavalerie y manquoit de fourrages, commença par assiéger les villes de Busca et de Dronero, qu’il prit en six jours ; et notre armée eut de quoi s’étendre et subsister à son aise. Il fit ensuite entrer dans la citadelle de Turin les munitions de guerre et de bouche nécessaires, malgré tout ce que le prince Thomas put faire pour l’empêcher.
Peu de temps après, ayant su que ce prince avoit envoyé un corps de cavalerie assez près de là pour y hiverner, il alla l’investir, et il l’enleva. Au commencement du printemps, le comte d’Harcourt ayant appris que le marquis de Léganez, à la tête de vingt mille hommes, avoit assiégé Cazal, que nous défendions pour le jeune duc de Mantoue, notre allié, il manda au vicomte de Turenne de le venir trouver à Pignerol, pour délibérer sur ce qu’ils devoient faire en cette rencontre. Le vicomte de Turenne détermina bientôt de comte d’Harcourt, en lui disant que Cazal nous étoit d’une telle importance, qu’il falloit promptement assembler le peu de troupes que nous avions, et y marcher sans perdre un moment de temps ; et qu’avant qu’on fût à moitié chemin, on recevroit immanquablement ordre de la cour de tout hasarder pour secourir cette place : ce qui arriva comme il l’avoit dit. Nous n’avions que dix mille hommes : néanmoins le comte d’Harcourt marcha aux ennemis avec son intrépidité ordinaire ; et après avoir reconnu leurs lignes, il les fit attaquer par le comte du Plessis-Praslin, qui fut à la vérité repoussé par trois fois ; mais le vicomte de Turenne y ayant enfin marché, il les força, et renversa tout ce qui se présenta devant lui : les Allemands lâchèrent pied aussi bien que les Espagnols, et prirent la fuite à droite ou à gauche, les uns vers le pont de Sture, les autres vers Frascinel, où ils avoient un pont sur le Pô. Le vicomte de Turenne les poursuivit tant que le jour dura. On leur prit douze pièces de canon, six mortiers, vingt-quatre drapeaux, toutes leurs munitions, la plus grande partie de leur bagage, et les papiers même du marquis de Léganez, qui fut obligé de se sauver avec tant de précipitation, qu’il n’eut pas le temps de les emporter. On leur tua trois mille hommes ; on en fit dix-huit cents prisonniers ; il s’en noya un grand nombre dans le Pô, et la nuit sauva le reste.
Comme nos troupes étoient fort animées par ce succès, le comte d’Harcourt cru qu’il devoit profiter de leur ardeur ; et ayant assemblé le conseil de guerre, pour y résoudre quelque entreprise, le vicomte de Turenne y proposa le siége de Turin. Les autres officiers généraux s’opposèrent à ce dessein, soutenant qu’il y auroit de la témérité à entreprendre d’assiéger, avec dix mille hommes, une ville où il y avoit une garnison de douze mille hommes sans les bourgeois, et qui pouvoit être secourue par une armée de quinze mille hommes, comme étoit encore celle du marquis de Léganez. Mais le vicomte de Turenne ayant persisté dans son avis, et ayant représenté que les affaires du roi seroient absolument perdues en Piémont, si le prince Thomas se rendoit une fois maître de la citadelle de Turin, dont on ne pouvoit empêcher la prise qu’en assiégeant la ville, le comte d’Harcourt se déclara pour le sentiment du vicomte de Turenne.
Le siége de Turin ayant été ainsi résolu, on y marcha aussitôt. On se saisit du pont, qui est sur le Pô ; du couvent des Capucins, qui est sur une hauteur, à la droite de ce fleuve ; du Valentin, maison de plaisance des ducs de Savoie, qui est à la gauche, et de tous les autres postes avantageux qui sont aux environs. On renversa à coups de canon les moulins de la ville qui étoient sur la rivière nommée la petite Noire. On fit des lignes de circonvallation et de contrevallation, et on serra la place d’autant qu’on le pouvoit, dans l’espérance qu’en n’y laissant rien entrer, on l’affameroit en peu de temps.
Le marquis de Léganez, regardant cette entreprise du comte d’Harcourt comme une occasion favorable que la fortune lui présentoit pour se venger de l’affront qu’il venoit de recevoir devant Cazal, manda au prince Thomas qu’il alloit marcher à son secours ; que pour cette fois le comte d’Harcourt ne lui échapperoit pas, et que les dames de Turin pourroient louer d’avance des fenêtres sur la grande rue, pour le voir passer prisonnier. Il grossit son armée des garnisons de la plupart des places du Milanez, et vint avec dix-huit mille hommes sur la montagne qui est au-dessus des Capucins, au-delà du Pô, à dessein de passer ce fleuve sur le pont de Turin. Mais il trouva ce pont si bien gardé, qu’il n’osa l’attaquer. Il décampa donc ; et comme il prit son chemin par derrière les montagnes de Sanvito et de Covoretto, qui bordent le Pô, le comte d’Harcourt se douta bien qu’il vouloit aller passer ce fleuve à Montcalier, au-dessus de Turin ; il y envoya le vicomte de Turenne avec un détachement, pour s’opposer à son passage.
Quelque diligence que pût faire le vicomte de Turenne, lorsqu’il arriva à Montcalier, quatre à cinq mille des ennemis avoient déjà passé le Pô, et commençoient à se retrancher dans les cassines qui étoient en-deçà de ce fleuve. Il marcha à eux sans perdre un moment : ses soldats font difficulté de passer un ruisseau que les pluies de la nuit avoient fait déborder ; il le passe le premier ; il attaque les cassines que les ennemis avoient déjà percées pour s’y défendre ; il les en chasse ; il les taille en pièces, en les poussant vers le Pô, où tous ceux qui lui échappent se noient ; il brûle le pont qui n’étoit que de bois, et se retranche sur le bord du fleuve, vis-à-vis des ennemis. Cette action, ainsi exécutée, fit une telle impression sur l’esprit du marquis de Léganez, qu’il se retira vers le Rivigliasco, sous prétexte d’aller chercher un renfort de troupes, et laissa son armée sous la conduite de Carlo della Gatta, le plus brave et le plus entendu de ses officiers, qui lui promit qu’il la feroit passer de quelque manière que ce fût. Le vicomte de Turenne, ayant affaire à un homme qui avoit la réputation d’être le plus vigilant des ennemis, fit garder jour et nuit tous les gués qui étoient au-dessus de Montcalier ; de sorte que Carlo della Gatta n’osa ni les passer en sa présence, ni jeter des ponts en aucun endroit. Tout ce qu’il put faire fut de s’emparer de quelques petites îles qui étoient plus proches du bord du Pô, sur lequel il étoit, que de celui où nous étions. Le vicomte de Turenne trouva moyen d’y passer avant que les ennemis y eussent achevé leurs retranchemens ; il les en délogea ; et tous ceux qui y étoient furent encore, ou taillés en pièces, ou noyés dans le Pô. Mais le vicomte de Turenne y reçut un coup de mousquet à l’épaule, et fut obligé de se faire porter à Pignerol : ce que le marquis de Léganez ayant appris, il revint aussitôt à Montcalier, il jeta un pont sur le Pô, passa ce fleuve malgré tous nos efforts, alla resserrer le comte d’Harcourt dans son camp ; et peut-être n’y eut-il jamais en aucun endroit une pareille disposition d’armée, où les troupes des deux partis, également assiégeantes et assiégées, s’environnoient les unes les autres, et étoient de même tellement environnées, que le prince Thomas, qui assiégeoit le comte de Couvonges dans la citadelle, se voyoit assiégé dans la ville par le comte d’Harcourt, que le marquis de Léganez tenoit pareillement assiégé dans son camp.
En cette situation, le marquis de Léganez étant convenu d’attaquer nos lignes, pendant que le prince Thomas feroit une sortie ; le jour qu’ils avoient pris pour cela étant arrivé, le comte d’Harcourt fut vigoureusement attaqué tout à la fois du côté de la ville et du côté de la campagne. Le prince Thomas se rendit maître du Valentin ; et Carlo della Gatta ayant comblé nos lignes au quartier du marquis de la Motte-Houdancourt, qu’il força, entra dans Turin avec douze cents chevaux et mille hommes de pied : après quoi le marquis de Léganez ayant fait occuper le poste de Colegno, qui le rendoit maître de la petite Noire, comme il l’étoit du Pô, par Montcalier, où il avoit laissé quelques régimens, il empêcha qu’il ne nous vînt des vivres, ni de Suze, ni de Pignerol, et nous affama tellement dans notre camp, que tous les officiers généraux vouloient obliger le comte d’Harcourt à se retirer de devant Turin : lorsque le vicomte de Turenne, se trouvant guéri de sa blessure, amena de Pignerol à notre armée, un grand convoi de vivres et de munitions, malgré ce que put faire le marquis de Léganez qui le suivit dans toute sa route, voltigeant sur les ailes de son escorte pour l’enlever, et lui dressant toutes sortes d’embûches pour le surprendre.
L’arrivée de ce secours pensa désespérer le prince Thomas, qui étoit réduit dans Turin à une aussi grande disette de vivres que nous. Carlo della Gatta entreprit de soulager la ville, en faisant passer une partie de la garnison dans l’armée du marquis de Léganez, et crut en sortir comme il y étoit entré. Mais depuis que le vicomte de Turenne fut revenu dans notre camp, les choses changèrent de face. Carlo della Gatta, ayant voulu sortir de Turin, y fut ramené battant, et repoussé l’épée dans les reins. Les assiégés firent plusieurs autres sorties, où ils perdirent beaucoup de monde. Le marquis de Léganez tenta toutes choses pour forcer nos lignes et jeter des vivres dans la place, mais ce fut toujours sans succès. Le prince Thomas n’ayant pas mieux réussi dans une nouvelle sortie, où les assiégés firent tous les efforts dont ils étoient capables, se voyant réduit à la dernière extrémité, demanda enfin à capituler, et se rendit. Le marquis de Léganez, abandonnant la partie, repassa le Pô avec son armée ; et le comte d’Harcourt, s’en retournant en France, laissa la sienne sous le commandement du vicomte de Turenne, par ordre de la cour.
Comme nos troupes avoient extrêmement souffert au siège de Turin, le vicomte de Turenne leur donna tout le temps dont elles avoient besoin pour se rétablir ; mais dès qu’elles furent en état d’agir, quoique l’hiver ne fût pas encore fini, il les fit marcher à Moncalvo : il assiégea cette place, et s’en rendit maître en dix jours. Après la prise de Moncalvo, il passa le Pô, et alla mettre le siége devant Yvrée, où étoient tous les magasins du prince Thomas ; et ne doutant point que ce prince ne vînt en grande diligence pour y jeter du secours, il ne descendit point de cheval qu’il n’eût fait achever ses lignes, et qu’il n’eût assuré ses quartiers. Le prince Thomas ne manqua point d’accourir à Yvrée, persuadé que le vicomte de Turenne n’auroit pas eu le temps de pourvoir à la sûreté de son camp ; mais il le trouva si bien retranché, qu’il n’osa l’attaquer, et se flattant de lui donner le change, il alla mettre le siége devant Chivas pour lui faire abandonner celui d’Yvrée. Il est vrai que la ville de Chivas, où nous avions un pont sur le Pô, ne nous étoit pas moins importante que celle d’Yvrée. Mais le vicomte de Turenne, espérant d’être toujours assez à temps de secourir Chivas, n’abandonna point le siége d’Yvrée, et se contenta d’en presser vivement les travaux. Cependant le comte d’Harcourt ayant appris que le vicomte de Turenne avoit en si peu de jours pris Moncalvo, et qu’il avoit même assiégé Yvrée, fut piqué d’émulation jusqu’au milieu des délices de la cour. Il partit pour se rendre à Yvrée, et à son arrivée ayant fait donner un assaut à la place, il leva le siége, disant qu’il falloit tout abandonner pour secourir Chivas. Le prince Thomas, qui n’avoit point eu d’autre dessein que de nous faire lever ce siége, leva aussi celui de Chivas, avant que nous y fussions arrivés, et se retira au-delà du Pô avec son armée. Il semble que le comte d’Harcourt auroit dû, après cela, revenir assiéger Yvrée ; cependant, abandonnant toutes les vues que le vicomte de Turenne avoit eues en assiégeant cette place, il passa le Pô, et il alla prendre les villes de Ceva, de Mondovi et de Coni.
Quoique le vicomte de Turenne n'eût pas lieu d'être content du comte d'Harcourt, il travailla néanmoins de si bonne foi pour la gloire de ce général, aux siéges de ces trois places, que toute l'armée en fut dans la dernière surprise. Ce procédé augmenta l'estime que le cardinal de Richelieu avoit pour le vicomte de Turenne, et la confiance qu'il avoit en lui alla jusqu'à un tel point, qu'il n'y avoit aucune entreprise si difficile dont il ne tînt le succès assuré, dès que ce prince y avoit quelque part. Aussi ne se faisoit-il plus rien de grand en aucun endroit, qu'on ne l'y appelât aussitôt, comme il arriva l'année suivante, où le cardinal de Richelieu ayant formé le dessein de conquérir le Roussillon, pour pénétrer dans la Catalogne dont les habitans s'offroient à la France, et ayant même engagé le roi à y aller en personne, il y fit aussi venir le vicomte de Turenne, quelque nécessaire qu'il fût en Italie, où il étoit en état de rendre de grands services, par la connoissance qu'il avoit acquise de ce pays-là.
Sitôt que l'armée qui devoit agir en Roussillon fut assemblée, on marcha à Perpignan qui en est la capitale, dans le dessein d'assiéger cette place ; mais comme les Espagnols pouvoit la secourir par Collioure, où il leur étoit aisé d'aborder avec leurs vaisseaux, on se contenta de bloquer Perpignan, et on alla assiéger Collioure qui est par-là. Le gouverneur avoit fait faire quantité de forts et de redoutes tout autour de la ville : on les prit tous l'un après l'autre, l'épée à la main, et la ville fut contrainte de se rendre. On assiégea ensuite Perpignan : le siége dura plus long-temps ; mais enfin le gouverneur fut obligé à capituler. On se rendit maître après cela de la forteresse de Salces, et des autres places fortes sans beaucoup de peine ; et la conquête de toute la province fut faite en une seule campagne.
Ce fut dans ce temps-là que le duc de Bouillon, frère du vicomte de Turenne, s'étant trouvé impliqué dans un traité que le duc d'Orléans avoit fait avec l'Espagne, et ayant été arrêté à la tête de notre armée d'Italie qu'il commandoit, fut obligé, pour sauver sa vie, de livrer Sedan au roi, qui s'engagea à lui donner en échange plusieurs grandes terres, et à conserver le rang de prince à tous ceux de sa maison.
La possession de cette importante place, qui est demeurée depuis unie à la couronne, fut le dernier des avantages que le cardinal de Richelieu procura à la France ; et ce grand ministre mourut peu de temps après, craint, haï, envié et admiré de presque tout le monde.
Le cardinal Mazarin succéda à la place du cardinal de Richelieu auprès de Louis XIII, mais il n'y fut pas long-temps, car ce prince mourut cinq mois après, et laissa la reine Anne d'Autriche sa femme, regente du royaume durant la minorité de Louis XIV son fils, qui n'avoit que quatre ans et demi.
Cependant le vicomte de Turenne, qui étoit presque le seul qui se fût intéressé pour le duc de Bouillon durant sa détention, s'étoit donné tous les mouvemens qu'il est naturel de se donner en pareil cas pour un frère, mais sans manquer en rien de ce qu'il devoit à l'état, et il s'étoit comporté d'une manière si sage pendant tout le cours de cette affaire, que sa conduite redoubla l'estime qu'on avoit pour lui à la cour, et qu'on l'envoya servir dans notre armée d'Italie. On venoit de donner le commandement de cette armée au prince Thomas, qui avoit abandonné le parti des Espagnols pour se joindre à nous : mais comme on ne comptoit pas beaucoup sur son attachement à nos intérêts, on voulut envoyer avec lui un homme de la fidélité duquel on fût entièrement assuré, et ce fut le vicomte de Turenne qu'on choisit pour un poste d'une aussi grande confiance. Sitôt qu'il fut arrivé à l'armée, le prince Thomas marcha vers Alexandrie, ville du Milanez, qu'il fit investir de manière que les quartiers étant assez éloignés les uns des autres, les ennemis pouvoient facilement jeter du secours dans la place par les intervalles qui se trouvoient entre ces quartiers. C'est aussi ce que ne manquèrent pas de faire les Espagnols, qui tirèrent pour cela presque la moitié de la garnison de trin. Alors le prince Thomas, qui n'avoit feint de vouloir assiéger Alexandrie que pour engager les Espagnols à dégarnir Trin, alla mettre le siége devant celle ville dans toutes les formes. On attaqua les dehors avec beaucoup de vigueur, et ils furent bientôt emportés. Les Espagnols vinrent reconnoître nos quartiers pour tâcher de faire rentrer dans la place les troupes qu'ils en avoient tirées ; et n'y ayant pu réussir, ils feignirent d'en vouloir à Ast, et allèrent investir cette place : mais comme nous l'avions pourvue de tout ce qui étoit nécessaire pour soutenir un long siége, nous continuâmes celui de Trin sans rien craindre. Nous nous en rendimes enfin les maîtres, et le vicomte de Turenne se préparoit à marcher à de nouvelles conquêtes.
Mais la reine
régente sachant ce qu'un homme tel que lui pouvoit pour la défense
d'un état, lui envoya le bâton de maréchal de France,
et lui donna le commandement de notre armée d'Allemagne, quoiqu'il
n'eût encore que trente-deux ans, dans la vue de l'attacher entièrement
à son fils, et d'en faire un appui de sa couronne contre les entreprises
où son royaume ne pouvoit manquer d'être exposé par
les cabales et les factions qui sont comme inséparables d'une minorité.